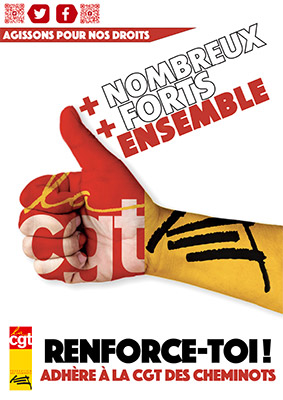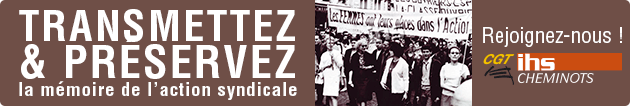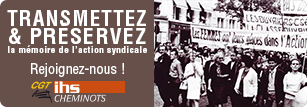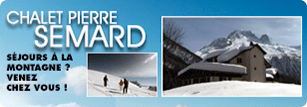Pourquoi une concurrence à tout prix ?
UFCM

L’Union Européenne, dans sa forme actuelle, est issue d’un long processus de construction, qui a débuté à la suite des deux conflits mondiaux du XXe siècle, et qui s’appuie sur un principe idéologique clair et sans ambiguïté ; réduire le champ d’intervention du politique et laisser agir le marché.
Un rouleau compresseur sans frein et sans marche arrière
Depuis le Traité de Rome et de manière continue, le droit à la concurrence tourne tous les jours à Bruxelles et soumet à une règle stricte tous les autres champs d’activité ; droit social, environnemental, services publics…
Cette situation est consacrée dans les Traités successifs par la répartition des domaines de compétences de l’Union, entre la Commission Européenne et les Etats membres. Ainsi, comme ses prédécesseurs, le Traité de Lisbonne prévoit que l’Union dispose d’une compétence exclusive (c’est-à-dire sans partage) en ce qui concerne l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Le grand marché unique européen est créé en complétant ce cadre juridique aux quatre grandes libertés de l’Union prévues à l’acte unique européen (liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux).
C’est dans ce contexte que sont menées toutes les politiques de libéralisation sur les services publics en réseau en Europe ; énergie, télécommunications, eau, et ferroviaire.
Une concurrence contreproductive
Présentée comme la seule solution aux problèmes de croissance et d’emploi, la définition européenne de la concurrence repose toutefois sur une conception volontairement erronée afin de dissimuler les véritables objectifs des politiques communautaires. Les conséquences et mérites de la concurrence sont issus de l’effort que fait chaque producteur de produits ou de services pour différencier sa production de manière à faire mieux que son concurrent.
Qu’une entreprise essaie de faire pareil que les autres, notamment celles déjà présentes dans la branche, et elle court à l’échec. Or, ce principe de différentiation se heurte à deux écueils ; l’un interne aux chemins de fer, l’autre propre à la position idéologique de la commission
européenne.
La particularité du transport guidé
Le fonctionnement d’un transport guidé comme le ferroviaire, mettant en mouvement exclusivement longitudinal un mobile sur une infrastructure, en gérant les croisements et les espacements et en protégeant les points de cisaillement, suppose de maîtriser les deux éléments ; le fixe et le mobile.
Il est dès lors indispensable d’aligner les intérêts et objectifs du gestionnaire d’infrastructure sur ceux de l’entreprise ferroviaire. Nul ne conçoit en effet que l’on fasse circuler un train sur une infrastructure sans en vérifier au préalable la conformité en termes de circulation, en qualité, en efficacité et en termes de sécurité. De ce point de vue, la multiplication des acteurs dans un système désintégré, comme le système français au dire même de Guillaume Pépy lors du colloque « Concurrence et régulation : quelles perspectives pour le transport ferroviaire ? » organisé par l’ARAFER le 29 juin dernier, est un facteur de complexification et de perturbation, de même qu’elle est un frein à l’innovation technologique, la recherche et le développement. Comment imaginer que nous aurions pu construire et exploiter le TGV, sans maîtriser totalement les interactions entre l’infrastructure et le train, adaptés l’un à l’autre, ceci pour une circulation à des vitesses commerciales que nous sommes les seuls à avoir atteint encore à ce jour ?
La position idéologique de la commission européenne et des instances de régulation
Parallelement à cette particularité intrinsèque au système ferroviaire, la commission européenne s’enferme dans des mécanismes qui brident toute innovation et toute adaptation (l’une des trois principales caractéristiques du Service Public). En cherchant à standardiser et homogénéiser produits et services au nom d’une concurrence libre et non faussée, celle-ci cantonne en effet la compétition entre opérateurs à la seule baisse des coûts de production.
Ceci par ailleurs sans baisse du prix aux usagers et de la contribution financière des Conseils Régionaux, mais par contre avec diminution de la qualité du service aux usagers et une augmentation de la pression sur les salarié-e-s. Cette position idéologique vise à créer des oligopoles privés dont l’objet est la rémunération des actionnaires, notamment par transfert des contributions publiques au titre des missions de service public vers ces derniers. Pour la CGT, la libéralisation des services publics est une opération de transfert financier du secteur public vers le capital privé.
quelles perspectives pour le transport ferroviaire ? »
Lors de ce colloque, Guillaume Pépy est intervenu comme patron d’entreprise sur les conditions préalables à réaliser pour avoir une concurrence sans distorsion aux dépens de l’opérateur historique. Guillaume Pépy : « Sur le débat européen. Il est de bon ton de dire « la bonne solution, c’est la séparation totale et absolue entre l’infrastructure et l’opérateur ». Au passage, il faut noter que l’UE est beaucoup plus pragmatique que cela, puisqu’elle admet différents systèmes, pourvu que certaines règles soient respectées. Quel est le pays d’Europe dans lequel il y a le plus de concurrence ? Ce n’est pas l’Angleterre où il y a des monopoles régionaux, avec la concurrence introduite pour le marché. Le pays où il y a le plus de concurrence, c’est l’Allemagne. 40% du Fret est fait par les concurrents de la DB. 35% des TER sont faits par les concurrents de la DB. C’est très embêtant ;
l’Allemagne est le pays qui a l’organisation la plus intégrée ! Il n’y a pas deux chefs. Il n’y a pas Patrick Jeantet et moi ! Il y a un chef : Richard Lutz. C’est une organisation intégrée. Si je dis cela, c’est parce que je pense qu’il existe des sujets-systèmes dans le ferroviaire : la sécurité, la robustesse, la qualité des sillons. Ces sujets- systèmes demandent à être travaillés entre toutes les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d’infrastructure. Donc ce n’est pas en morcelant le système qu’on résoudra les problèmes. C’est en ayant des règles strictes, évidemment, mais en permettant le travail en commun de tous les opérateurs (dont la SNCF qui fait aujourd’hui 95% des trafics) et le gestionnaire d’infrastructure.
Que la nécessité d’avoir une organisation et une production ferroviaire intégrée défendue par la CGT depuis des années, fasse apparemment consensus avec la direction de l’entreprise, ainsi qu’avec des « observateurs reconnus » (voir le rapport sur la robustesse) ne peut trouver qu’une oreille attentive de la part de l’UFCM-CGT… Mais plus qu’une oreille attentive, la CGT a un projet qu’elle est toujours prête à présenter et à débattre avec la collectivité nationale.
Les rolling stocks !
Souhaitant jouir pleinement de la propriété d’un matériel qu’elles ont souvent acheté ou contribué à acheter, les Régions envisagent d’en confier la gestion à des structures financières (rolling stocks) destinées à louer celui-ci auprès des différents opérateurs.
Les capacités de différentiation de ces derniers quant à leur capacité et qualité d’accueil se limiteront à la couleur et la texture des selleries, ainsi qu’à la couleur du flocage des matériels. C’est donc sur le contenu et le niveau de service que se jouera la différentiation entre opérateurs, impactant le contenu des métiers de cheminots dont la dimension sécurité est indéniable, et le niveau de prestations toujours et exclusivement soumis à la pression sur les coûts. L’autre risque est l’externalisation de la maintenance.
Pour le secteur ferroviaire, la réglementation européenne actuelle permet encore de déroger à des appels d’offres où les opérateurs se répartissent les marchés entre eux pour faire fructifier leurs profits. Pour la CGT, l’attribution directe reste possible si tant qu’il y ait une volonté politique de faire de l’entreprise publique SNCF une entreprise nationale et non étatique, et un outil du Service Public et d’aménagement du territoire dans le cadre d’une gestion démocratique. C’est la raison pour laquelle pour la CGT, ce sont les usagers qui doivent faire l’objet d’une égalité de traitement, pas les opérateurs et qu’elle revendique un service public libre et non faussé.