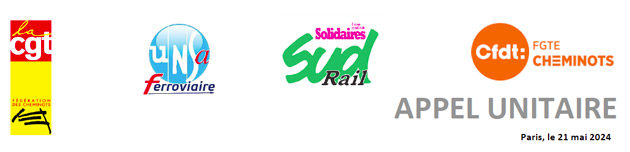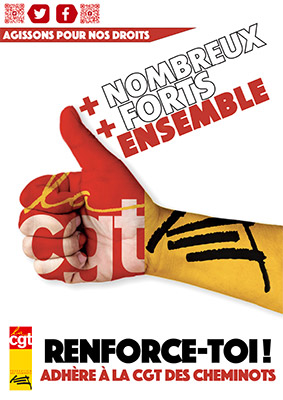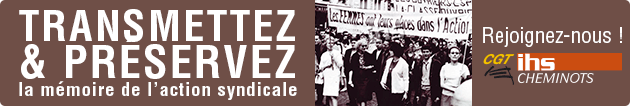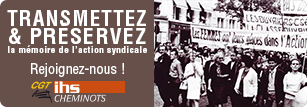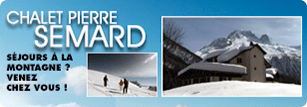Lettre ouverte à l’UTP et au Président de la SNCF
Madame, Monsieur,
La CGT est à l’initiative des luttes ayant conduit à la création des conventions collectives nationales instituées par le Front populaire au travers de la loi du 24 juin 1936.
Pour la CGT, la négociation doit être un moyen de rééquilibrer l’inégalité de la relation de travail entre le salarié et l’employeur. L’État est garant de l’intérêt général et doit oeuvrer à réduire les inégalités tandis que l’accord entérine un compromis qui concrétise un rapport de forces entre des positions contradictoires.
Aujourd’hui, force est de constater que gouvernement et patronat font front commun pour effacer l’esprit de 1936 et réduire les droits des salariés, notamment des cheminots. Les tenants du pouvoir organisent le recul des lois protectrices des plus faibles pour laisser place à une négociation collective tronquée. Le patronat a ainsi les mains libres pour remettre en cause les garanties par dénonciation des accords collectifs, des usages, voire des CCN, comme la VFIL.
Pour asseoir le poids patronal, le gouvernement libéral en place intervient ensuite pour contraindre les négociations en soutenant les positions patronales. En attestent, dans notre champ professionnel, qui ne fait pas exception en la matière, les exemples du décret socle sur le temps de travail de 2016 et plus récemment du décret relatif aux classifications et rémunérations, qui vient apposer le sceau étatique sur une recommandation patronale jusqu’alors dépourvue de contraintes sur les cheminots.
La négociation de la CCN ferroviaire a été imposée par la loi rétrograde du 4 août 2014, que la CGT a combattue avec les cheminots alors que d’autres organisations la soutenaient, et par laquelle le gouvernement a institué, sous la pression du patronat, un champ d’application des plus restrictifs. En sont notamment exclus la restauration ferroviaire, les entreprises qui déclarent pour activité principale les travaux publics, les travaux sur chantiers fermés ou encore la maintenance « hors réparation » du matériel roulant.
Pour réduire la mise en concurrence des salariés, imposer un haut niveau de sécurité et de véritables conditions de vie et de travail optimales pour tous, la CGT revendique l’intégration dans la CCN de l’ensemble des salariés du ferroviaire.
Contrairement aux autres branches professionnelles, où la construction des CCN s’est faite à partir du socle de droits conséquents existants dans des entreprises souvent anciennes, la branche ferroviaire, dont l’existence vise uniquement la mise en concurrence des salariés, suit un chemin inverse. L’objectif du patronat de la branche ferroviaire, représenté par l’unique organisation patronale UTP, est de créer un minimum de droits pour les cheminots hors SNCF, afin d’imposer le recul aux cheminots de l’opérateur historique, qui représentent 98 % de la branche actuellement.
En parallèle, le patronat de la branche, dans son ensemble, use d’un mécanisme de « vides communicants » à dessein d’abaissement des droits des cheminots de la SNCF, se servant à l’envi des stipulations conventionnelles moins-disantes de branche pour modifier le corpus réglementaire interne à l’entreprise historique, et réciproquement en obérant à partir de l’entreprise les sujets futurs de négociations de branche, tels que le droit syndical.
Le patronat se sert en revanche de la CCN pour ouvrir le maximum de droits à dérogation dans les entreprises. Pour exemple, l’intégration du forfait en jours dans le volet « Aménagement du temps de travail » au niveau de la branche ne fixe aucun garde-fou mais permet aux employeurs de l’imposer à leurs salariés.
La réforme ferroviaire de 2018, qui a mis fin au recrutement au statut, est le prolongement de celle de 2014. Les négociations de branche engagées sur la classification des métiers et la rémunération des cheminots ont échoué faute de volonté du patronat et de certaines organisations syndicales de construire des droits de haut niveau pour tous les cheminots. L’accord de branche du 6 décembre 2021 sur cette thématique est une récidive de celui de 2020 frappé d’opposition majoritaire.
Cet accord rejette toute reconnaissance des diplômes à l’embauche et en cours de carrière ; il est fondé sur une polyvalence accrue par la réduction drastique du nombre de métiers, conduisant à un abaissement du niveau de maîtrise par les cheminots et à la non-reconnaissance des qualifications ; il impose une restriction du déroulement de carrière, d’une part dans son niveau nettement inférieur à l’existant à la SNCF, d’autre part à la main du patronat et de son arbitraire ; et enfin, en tout état de cause, très hypothétique car limité dans son automatisme aux salaires qui ne seraient pas supérieurs aux minima de branche.
Cet accord se fonde sur des minima salariaux annuels, ne permettant pas de neutraliser les fluctuations en cours d’année et dès lors impropres à répondre aux aspirations des cheminots dont le budget s’établit par mois, et non par année.
En outre, cet accord remet en cause les facilités de circulation des cheminots et, sous couvert de pressions ministérielles, grave dans le marbre la qualification d’avantage en nature ouvrant la voie à la fiscalisation et aux cotisations sociales.
Le traitement de ces droits au travers d’un accord de branche dédouane l’État de ses responsabilités en donnant valeur contractuelle à un droit jusqu’alors issu du décret de 1938 et ayant donc survécu plus de 80 ans.
La branche ferroviaire est constituée d’environ 140 000 cheminots, dont 137 000 salariés de la SNCF, ce dont il résulte qu’en réalité, les négociations de branche portent à près de 98 % sur les conditions de vie et de travail des cheminots de la SNCF. Les conséquences de ces accords sur les cheminots de la SNCF sont donc le fruit escompté des positionnements patronaux.
Les stipulations de branche minimalistes, conjuguées aux dispositions réglementaires et législatives conçues sur mesure pour le patronat, permettent ainsi par exemple à la SNCF de remettre en cause les dispositions statutaires, de supprimer les conseils de discipline dans les filiales créées par la SA Voyageurs, de s’attaquer au droit syndical, de tripler la durée du préavis en cas de démission pour les cadres et de la doubler pour les autres agents, de restreindre le déroulement de carrière d’une partie des cheminots contractuels, d’en supprimer le contrôle social, de remettre en cause le dictionnaire des filières, d’exclure de la filière Traction les agents de conduite exerçant hors RFN sur STRMTG, ou encore de prendre en compte les primes Traction et de Travail des ADC et ASCT contractuels dans l’évaluation de la rémunération annuelle garantie, provoquant un fort abaissement du salaire de base de ces cheminots.
Les stipulations conventionnelles de branche visent également la remise en cause de la contrepartie salariale du travail des cheminots. L’objet du salaire est à la fois de reconnaître les qualifications et de permettre de vivre dignement. La reconnaissance des qualifications passe par la rémunération des diplômes, des formations qualifiantes, de la technicité et de l’expérience acquise tout au long de la carrière. Tout diplôme, toute expérience, apportent un gain de productivité dont l’employeur bénéficie et qu’il doit donc rétribuer. Or, le patronat du ferroviaire refuse de payer cette qualification.
En outre, à l’instar de la direction SNCF, le patronat refuse de compenser la hausse générale des prix par des augmentations générales de salaire, alors même qu’il contribue à cette inflation dans ses pratiques commerciales. Relativement à la hausse des prix, les pertes de pouvoir d’achat cumulées pour les cheminots s’élèvent à près de 30 % depuis 1983. L’indice Insee évaluant cette hausse des prix est lui-même un facteur de minimisation.
Devenu un idéal type de consommation théorique et non de mesure statistique de l’évolution réelle des prix pondérée par les budgets de consommation des ménages, il est désormais élaboré à partir de données de caisse sur la base de référentiels d’articles établis par les agences marketing de la grande distribution, donc par le patronat, puis passées à la moulinette d’algorithmes obscurs.
L’indice Insee est devenu un outil politique pour refuser les augmentations des salaires et des pensions, par un abaissement fictif tel que l’indice « hors tabac », qui sous-estime largement l’augmentation réelle du coût de la vie. Plusieurs études évaluent cette sous-estimation à 1 point par an.
À la SNCF, les salaires des cheminots sont gelés depuis 2014 alors que l’inflation cumulée depuis cette date s’élève, selon les chiffres officiels, à plus de 12 %. Dès lors, ce sont l’expérience, la qualification et la montée en compétence des cheminots, déjà sous-payées en application des accords de branche, qui compensent les pertes de pouvoir d’achat liées à l’inflation. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui de 85 % des branches professionnelles qui présentent des départs de grille en dessous du Smic.
Selon la Dares, le salaire mensuel de base moyen a progressé sur un an de 2,3 % au premier trimestre, mais cela reste inférieur à la hausse des prix de 4,6 % sur la même période. Les négociations salariales courent donc après l’inflation pendant que le patronat engrange des gains de productivité.
De toute évidence, les stipulations conventionnelles de la branche ferroviaire ne permettent pas de protéger les cheminots de la hausse des prix, tant l’indigence des minima et les méfaits de leurs mécanismes d’annualisation sont patents.
C’est pourquoi la Fédération CGT des cheminots exige l’ouverture sans délai d’une véritable négociation relative à la classification et la rémunération des cheminots. Cette négociation qu’exige la gravité de la situation requiert que les organisations signataires de l’accord de branche de 2021 s’en défassent et participent à la construction réelle de droits pour les cheminots.
Pour répondre aux besoins des cheminots, cette négociation doit porter en termes de salaire sur :
- la considération mensuelle du salaire ;
- une grille reconnaissant les qualifications à l’embauche et acquises en cours de carrière ;
- le relèvement des minima pour un salaire de début de grille égal au Smic, que la CGT revendique à 2 000 € brut ;
- une périodicité annuelle des négociations salariales de branche ;
- l’indexation des minima salariaux sur l’inflation pour répondre à la hausse des prix dont profitent les entreprises.
Dans l’attente d’une suite favorable donnée à cette demande légitime répondant aux revendications des cheminots, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses.
Laurent BRUN
Secrétaire général